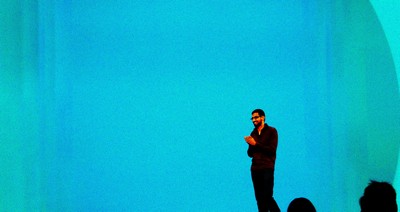
L’époque où les entreprises technologiques pouvaient choisir de ne rien divulguer sur l’impact environnemental et énergétique de leurs produits est révolue. Conscientes qu’il vaut mieux désormais diffuser un discours qu’elles peuvent contrôler plutôt que de laisser les critiques importunes envahir les ondes, les grandes entreprises divulguent des informations triées sur le volet (parfois à un public de journalistes incapables de décoder les chiffres, peu enclins à poser des questions, ou les deux).
En juin dernier, Sam Altman a inclus cet extrait dans un article du blog OpenAI :
Les gens sont souvent curieux de savoir combien d’énergie consomme une requête ChatGPT ; une requête moyenne consomme environ 0,34 wattheure, soit à peu près ce qu’un four consommerait en un peu plus d’une seconde, ou ce qu’une ampoule à haute efficacité consommerait en quelques minutes. Elle consomme également environ 0,000085 gallon d’eau, soit environ un quinzième d’une cuillère à café.
Bien qu’aucune information n’ait été fournie sur la manière dont ce chiffre avait été calculé, il a été largement relayé et a fait beaucoup de bruit sur LinkedIn. Il y a quelques semaines, Mistral AI a publié un rapport plus détaillé intitulé « Notre contribution à une norme environnementale mondiale pour l’IA » : (...)
Et cette semaine, Google a publié un nouvel article important, résumé dans cette vidéo. (...)
Il s’agit de loin des informations les plus détaillées publiées par une entreprise technologique sur la consommation énergétique de ses propres logiciels2, sachant que la base de référence sur laquelle nous nous appuyons ici était, il y a quelques mois, « littéralement rien », et il y a quelques semaines, « quelques mots prononcés par Sam Altman dans un blog ».
Quelques experts ont salué le rapport de Google, mais ont poliment averti que l’entreprise ne donnait peut-être pas une image complète de la situation. La réaction la plus courante a été l’approbation de ceux qui ont toujours su que l’IA générative était respectueuse de l’environnement. (...)
Aïe. « Basé sur les vibrations ». Google sait qu’en présentant un article qui a l’esthétique d’une recherche scientifique évaluée par des pairs, cela donnera à des journalistes comme Kevin Roose l’impression d’être les personnes intelligentes et très sérieuses dans la pièce, par rapport aux activistes farfelus. Mais ce n’est pas seulement une question d’esthétique. Voyons comment ils ont brossé leur tableau.
Les problèmes liés à la divulgation sélective de Google
Google établit une limite claire pour ce qu’il calcule dans son article complet, incluant non seulement les puces informatiques traitant la requête, mais aussi les machines au ralenti et les frais généraux (tels que les systèmes de refroidissement ou de conversion d’énergie). (...)
Ce qui semble être un pas énorme vers la transparence et la divulgation doit être considéré dans le contexte de l’absence totale de mesures antérieures. Partant d’une base où rien n’était divulgué, le secteur peut désormais choisir de définir soigneusement le discours autour de ce qu’il souhaite précisément et être félicité pour cela.
Examinons de plus près les problèmes soulevés par ce qui a été présenté.
L’utilisation de la « médiane » masque la situation dans son ensemble
Le titre de leur article est « Mesurer l’impact environnemental de la mise en œuvre de l’IA à l’échelle de Google », mais cet article n’a rien à voir avec « l’échelle ». Il fournit une estimation de l’impact d’une seule requête textuelle. De plus, il fournit l’impact de la requête textuelle « médiane » : c’est-à-dire que, dans leur ensemble de données total de requêtes envoyées à Gemini, ils ont choisi celle qui se trouvait au milieu. (...)
L’utilisation de tout type de résumé statistique des données, plutôt que l’impact énergétique et climatique global sur l’ensemble du système, donnera toujours une image trompeuse. Ils mentionnent que leurs données sont biaisées, mais ils ne précisent pas dans quel sens. Si un nombre important de requêtes « raisonnées » à forte consommation d’énergie faussent leur ensemble de données, cela signifie que la consommation totale d’énergie de toutes les requêtes sera très élevée, la responsabilité incombant en grande partie à quelques requêtes très gourmandes en énergie.
Cela est d’autant plus important que nous avons pris connaissance cette semaine d’un nouvel article de recherche qui montre que la consommation d’énergie liée à la génération de texte augmente considérablement à chaque petit gain de précision obtenu grâce à l’utilisation de modèles de « raisonnement » gourmands en énergie. (...)
Il aurait été très facile de fournir la plage, l’écart, la moyenne et la médiane, voire l’ensemble des données réelles, afin d’éviter toute ambiguïté. Toute allusion à une vision globale du système plutôt qu’à la responsabilité individuelle est supprimée de cet article. Il s’agit clairement d’un choix délibéré : si Google divulguait l’impact du système sur la production, celui-ci apparaîtrait probablement sous un jour bien plus défavorable.
Cela ne concerne qu’un seul type de système génératif
La génération de texte par un chatbot est de loin la forme de système génératif la moins énergivore. Dans son récent rapport sur l’énergie et l’« IA », l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a estimé l’impact énergétique de différents types de génération, ce qui montre bien les différences (...)
Google s’efforce activement d’encourager l’utilisation de la génération vidéo. Les vidéos sont devenues incontournables sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok et Instagram, et il est clair que Google souhaite être celui qui les fournit. Même si cela ne représentera évidemment pas la majeure partie des requêtes, cela constituera probablement une part importante de la consommation d’énergie, et c’est manifestement la raison pour laquelle ils l’excluent de leur analyse. (...)
Il est intéressant de noter que Google a clairement indiqué qu’il était parfaitement capable de déterminer la consommation énergétique très spécifique des systèmes génératifs. L’entreprise pourrait partager les mêmes informations sur les images et les vidéos, mais elle choisit de ne pas le faire. Je pense que cela en dit long.
L’IA générative n’est pas seulement « utilisée », elle est imposée. (...)
Je suis prêt à parier qu’une grande partie (sinon la majorité) des requêtes de génération de texte se font sans intention humaine réelle et claire.
L’anxiété avec laquelle les entreprises technologiques ont intégré des systèmes génératifs dans leurs services existants est ahurissante. Vous ne pouvez pas envoyer une requête de recherche dans Google sans qu’il génère en même temps un paragraphe de texte, aussi absurde ou inexact soit-il. (...)
Ce récent article de recherche – et le site web qui l’accompagne – explore une grande variété d’exemples démontrant comment les interfaces sont conçues pour inciter les utilisateurs à utiliser des outils génératifs.
Les entreprises ont recours à des astuces telles que la mise en évidence excessive des boutons et des barres d’outils, les surlignages graphiques, les interruptions par des bannières et des pop-ups, ainsi que des fonctions toujours actives qui ne peuvent pas être désactivées (ou qui sont difficiles à désactiver).
Les chatbots sont littéralement présentés comme des outils magiques et polyvalents, sans aucune limite d’utilisation. Ils sont anthropomorphisés en « assistants », là pour « aider ». Ils sont littéralement partout. (...)
Ceci est important : ces entreprises ne peuvent pas gagner d’argent sans fabriquer activement l’utilisation de services génératifs.
À quoi bon informer les gens de leur consommation d’énergie par requête alors qu’une grande partie de la consommation énergétique globale provient de l’activation artificielle ou forcée de textes génératifs ? Et comment Google peut-il prétendre se soucier de son impact environnemental alors qu’il déploie tant d’efforts pour maximiser le nombre de requêtes, que les utilisateurs le veuillent ou non ?
Comment l’intensité est devenue la meilleure alliée des géants de la technologie
Le fait que trois acteurs mondiaux majeurs du domaine génératif aient divulgué des informations sur l’intensité par requête à quelques semaines d’intervalle n’est certainement pas une coïncidence. (...)
Récemment, Andy Masley, directeur de « Effective Altruism DC », a rédigé et publié deux articles très longs et très détaillés sur Substack4, tous deux présentant l’argument selon lequel « l’utilisation de ChatGPT n’est pas mauvaise pour l’environnement ». J’ai mentionné l’affiliation de Masley parce que cela me semble important : « l’altruisme efficace »5 est centré sur la quantification empirique de l’impact d’un choix de mode de vie et sur la sélection des choix les plus efficaces. On comprend aisément pourquoi, lorsqu’on se concentre uniquement sur la consommation d’énergie d’une requête textuelle, Masley présente facilement le fait d’éviter ces requêtes comme ayant un impact quasi nul sur l’action climatique personnelle, par rapport à d’autres options (...)
Il s’agit d’une représentation étrange, absurde et légèrement amusante de la manière dont le mouvement climatique a réagi aux textes, images et vidéos génératifs.
Historiquement, l’approche des grandes organisations climatiques en matière de consommation d’énergie numérique a consisté à encourager les entreprises technologiques à investir dans le financement des énergies renouvelables, et cela a parfaitement fonctionné. De nombreuses ONG importantes restent en dehors du débat sur les centres de données, et on trouve même des exemples d’ONG qui utilisent activement des systèmes génératifs, ou d’autres groupes comme RMI qui se concentrent sur des solutions technologiques axées sur la flexibilité et l’énergie. On trouve également des organisations et des campagnes beaucoup plus critiques, qui se concentrent principalement sur l’organisation communautaire autour de manifestations contre les centres de données ou contre les entreprises énergétiques peu scrupuleuses qui tentent d’exploiter l’engouement pour construire de nouvelles installations fonctionnant aux énergies fossiles.
Je n’ai encore trouvé aucune organisation ni aucun environnementaliste de premier plan incitant les gens à poser des questions à ChatGPT6 (c’est souvent tout le contraire).
Au contraire, je suis chaque jour horrifié de voir à quel point mes collègues du mouvement pour le climat ont adhéré à l’engouement général en se fiant à la génération de texte pour remplacer la pensée critique, la recherche et l’écriture. De nombreux acteurs des mouvements environnementaux et climatiques rejettent également la croissance des centres de données, la qualifiant d’hystérique et insignifiante.
Hannah Ritchie, analyste chez Our World In Data, a publié un article présentant des comparaisons très similaires, basées sur les travaux de Masley, et Ritchie a publié une mise à jour dès que Google a publié son nouveau rapport, créant ainsi une version actualisée du même récit. (...)
Cette comparaison est erronée en partie parce qu’elle occulte le fait que les interactions avec les systèmes génératifs constituent simplement une demande totalement nouvelle ou remplacent une demande nettement plus efficace. J’ai vu des gens utiliser des systèmes génératifs pour créer des carreaux carrés sur lesquels figurait du texte brut. Cela devrait être comparé au coût énergétique de la saisie de texte dans une zone de texte dans PowerPoint, et non au coût énergétique du chauffage des aliments ou du fonctionnement d’énormes écrans LCD.
Effectuer un calcul à l’aide d’un chatbot, l’une des fonctions les plus utilisées, consomme plusieurs millions de fois plus d’énergie que l’utilisation d’une calculatrice et est beaucoup plus susceptible d’être complètement erroné. Le faire à l’aide de modèles de « raisonnement » est plus susceptible d’être précis, mais consomme des dizaines de millions de fois plus d’énergie. C’est la pire forme de gonflement numérique induit par l’anxiété des dirigeants technologiques qui ait jamais existé. (...)
Comme je l’ai écrit ici, cela s’apparente à la manière dont l’industrie automobile a créé une situation d’encombrement routier toujours plus grave afin de maximiser ses profits, ou à la manière dont les fabricants de plastique ont inventé leur propre nécessité à travers les emballages alimentaires à usage unique. La responsabilité personnelle de l’utilisateur fait partie de cette histoire, mais elle n’en est qu’une petite partie, et c’est pourquoi le mouvement pour le climat ne se concentre pas excessivement sur elle dans le cas de ChatGPT, des SUV ou des plastiques à usage unique. Il se concentre sur les problèmes systémiques et les entreprises.
Il convient de noter ici que boycotter les systèmes génératifs (comme je le fais) reste une action significative et importante, et qu’il faut encourager les autres à le faire7. Si vous le faites parce que vous voulez économiser des grammes de dioxyde de carbone comme des pièces dans une tirelire, cela n’aura pas un effet bouleversant. Je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle la plupart des gens le font. Je pense que la plupart des gens le font parce qu’ils trouvent écœurant de contribuer activement à gonfler les statistiques d’une industrie qui fait preuve d’un manque flagrant d’éthique de multiples façons choquantes.
Je pense que ces publications Substack ont probablement influencé la réflexion des entreprises qui cherchent à contrôler le discours public autour de leur impact. Anthropic a même spécifiquement fourni la publication Substack d’Andy Masley lorsqu’on lui a demandé de partager plus d’informations sur sa consommation d’énergie.
En mettant en avant l’impact par requête, les auteurs de Substack et les entreprises occultent le véritable problème des systèmes génératifs : ils sont survendus et surutilisés, dans une tentative anxieuse de réaliser des espoirs impossibles, même si ceux-ci sont artificiels plutôt qu’organiques (en termes de détournement de l’action réelle, c’est l’étrange pendant inversé de la manière dont les entreprises de combustibles fossiles ont exploité et popularisé le message de « l’empreinte carbone » pour détourner la responsabilité de l’action d’elles-mêmes).
L’industrie générative est nocive pour l’environnement
Au niveau de Google :
Si le discours général selon lequel les systèmes génératifs ont un impact énergétique et environnemental quasi nul était vrai, on pourrait s’attendre à ce que les chiffres globaux communiqués par l’entreprise reflètent une réduction de son empreinte environnementale et énergétique.
Comme vous l’avez probablement deviné, ou peut-être déjà su, Google, tout comme Microsoft et Meta, a largement dépassé ses objectifs climatiques en raison de la combinaison d’une consommation d’énergie directe en forte hausse et de l’impact climatique de la construction rapide de nouveaux centres de données. (...)
Une seule personne interrogeant un chatbot ne consomme pas autant d’énergie que le chauffage d’un repas ou le déplacement en voiture. Mais la mise en œuvre à plus grande échelle des systèmes génératifs (spam textuel « raisonné », images, vidéos, demande forcée par des astuces de conception, etc.) est très gourmande en énergie dans l’ensemble, et la situation empire chaque jour.
Regardez l’augmentation de la consommation totale d’énergie de Google. Comprenez-vous pourquoi ces entreprises ont été si enthousiastes à l’idée d’adopter le cadre narratif « par requête » en matière d’impact climatique et énergétique ?
Au niveau industriel :
Les impacts environnementaux de l’« IA » sont souvent ridiculisés comme étant basés sur des prévisions improbables de l’avenir. Mais vous pouvez trouver un nombre infini d’impacts matériels, réels et immédiats liés à l’essor actuel des centres de données. Il s’agit là de faits tangibles, et encore une fois, ce n’est pas ce à quoi vous vous attendriez si ces entreprises fournissaient des services inertes et économes en énergie qui « ne nuisent pas à l’environnement ». (...)
Les services numériques existants (tels que le streaming vidéo, le stockage de fichiers, les appels vidéo et les jeux) ont tous fait l’objet d’un examen minutieux en termes d’infrastructure physique et de coûts énergétiques, mais aucun d’entre eux n’a entraîné une telle hausse des chiffres.
Un bon exemple du caractère unique des logiciels génératifs est le projet de centre de données « Colossus » d’Elon Musk, absurdement surdimensionné, qui s’accompagnait d’une flotte massive de turbines à combustible fossile. L’ensemble de cette installation existe uniquement pour former et faire fonctionner le chatbot vicieusement raciste et climatosceptique de X, qui déverse chaque seconde des centaines de mensonges générés aléatoirement dans la tête de millions de personnes peu informées.
Essayez de citer un autre site web de réseau social qui inclut une fonctionnalité nécessitant son propre centre de données alimenté par des combustibles fossiles. Il s’agit véritablement d’un tout nouveau type d’infrastructure numérique ultra-gonflée, beaucoup plus proche du minage de bitcoins par force brute que du streaming vidéo ou des jeux vidéo.
Vous pourriez facilement rédiger un article Substack soulignant qu’une seule requête Grok ne représente qu’une infime partie de votre consommation énergétique quotidienne, mais cela ne consolerait en rien les communautés de couleur qui étouffent sous les émanations de cette fonctionnalité. (...)
Il en va de même pour Meta, qui construit trois centrales électriques au gaz pour alimenter en énergie électrique un immense nouveau centre de données en Louisiane. Oracle vient d’annoncer une capacité de 1,4 gigawatt pour son centre de données alimenté à 100 % par des combustibles fossiles. Un opérateur de centre de données irlandais a fait valoir que « le fait d’utiliser le gaz comme combustible principal des centrales électriques a contribué à la décarbonisation du réseau national ». Au Texas, l’essor massif des gaz fossiles est alimenté par la croissance des centres de données, ce qui se traduit par un impact sur les émissions équivalent à celui d’environ 30 nouvelles centrales électriques au charbon en termes de gaz à effet de serre. Crusoe, une entreprise qui, jusqu’à récemment, se consacrait entièrement à l’exploitation minière de bitcoins, s’efforce désormais de déterminer comment les combustibles fossiles peuvent alimenter les centres de données « IA » (...)
Une communauté de Virginie a récemment fait échouer le projet de construction d’une centrale à gaz fossile de 3,5 gigawatts destinée à alimenter un nouveau centre de données. D’après mes calculs, si ce projet avait abouti, il s’agirait de la deuxième plus grande centrale à gaz des États-Unis. (...)
Au niveau national :
La croissance des centres de données dans le monde s’est principalement concentrée en Amérique, et elle est principalement liée aux types de matériel utilisés pour alimenter la génération de textes, d’images et de vidéos. La majeure partie de la croissance de la demande en électricité aux États-Unis est liée aux centres de données.
La demande croissante en électricité aux États-Unis a entraîné le maintien, plutôt que la diminution, des centrales à charbon et à gaz du pays, car toutes les nouvelles énergies renouvelables ont été détournées pour répondre à la nouvelle demande. (...)
Au cours des 16 derniers mois, la demande en électricité aux États-Unis a atteint des niveaux records (pour le même mois chaque année). Les émissions maximales de 2025 ont été supérieures à celles des quatre dernières années. Il s’agit d’un phénomène systémique, et non saisonnier : le réseau électrique américain, saturé par les centres de données, a commencé à montrer des signes de faiblesse.
J’ai vu de nombreux exemples où la croissance des centres de données était rejetée au motif qu’elle ne représentait qu’un faible pourcentage de la croissance mondiale totale de l’énergie utilisée par l’espèce humaine (avec la réserve qu’il pouvait y avoir des effets locaux concentrés). Il est assez remarquable de constater à quelle fréquence cette question est écartée parce que les pourcentages sont inférieurs à 10 %, et lorsque je demande à partir de quel pourcentage les centres de données seraient considérés comme un problème, je n’obtiens jamais de réponse (et encore moins une réponse claire).
Aux États-Unis, la croissance des centres de données joue clairement un rôle majeur dans la dynamique de la production de charbon et de gaz. Elle représente une part importante de la croissance de la demande et est en grande partie responsable de l’augmentation de la production de charbon et de gaz sur le réseau (avant même de prendre en compte les nouvelles centrales à gaz construites en masse dans la précipitation au détriment de communautés historiquement défavorisées). (...)
Si cette même croissance se manifeste avec la même vigueur dans d’autres régions du monde, elle aura le même effet immédiat et quantifiable. Il est vrai que les centres de données sont un problème local, avec des problèmes de pollution atmosphérique, d’accaparement des terres et d’augmentation rapide des factures d’électricité en raison de la congestion du réseau. Mais leur taille et leur ampleur ont des répercussions clairement perceptibles au niveau des États et des pays, où le bombardement intensif a été le plus intense.
Conclusion
Il est trompeur de présenter une seule requête à un chatbot comme si elle constituait la réponse définitive à l’impact de l’industrie sur l’énergie, le climat et l’eau.
Cela occulte les différents types de requêtes : textes « raisonnés » ultra-longs, images et vidéos. Cela ne permet pas de savoir si les requêtes sont consciemment demandées, imposées ou induites à l’aide d’astuces de conception d’interface douteuses. Les entreprises qui gèrent une grande partie de l’infrastructure numérique mondiale imposent une surconsommation, à l’instar d’un service des eaux qui installerait des milliers de robinets ouverts pour gonfler ses chiffres de distribution d’eau.
Cela occulte le volume considérable de requêtes envoyées. Cela occulte le fait qu’il s’agit soit d’une demande énergétique entièrement nouvelle, soit du remplacement d’une méthode plus efficace (voir : calculatrices).
Cela réduit l’acte politiquement puissant que représente le boycott d’une industrie nuisible à un calcul individualiste approximatif. Cela a été fait d’une manière qui aide activement l’industrie à tel point que les plus grandes entreprises sont devenues les parrains des discours rassurants sur l’empreinte carbone.
Le cadre narratif par requête donne une image diamétralement opposée à celle que nous voyons lorsque nous examinons ce qui compte vraiment pour l’environnement et le climat : les chiffres absolus.
Les régions où les centres de données sont très concentrés connaissent une croissance accélérée de la demande en électricité, ce qui encourage l’utilisation des combustibles fossiles, ralentissant ainsi les progrès en matière de climat, voire les inversant complètement. La sphère d’influence s’étend des villes aux États, puis aux pays. Les entreprises qui les possèdent ne peuvent que partiellement masquer le recul important dans leurs divulgations globales.
Les énergies renouvelables, qui devraient remplacer les combustibles fossiles, finissent par répondre à la nouvelle demande des centres de données, accordant au charbon et au gaz des années et des décennies supplémentaires de dommages immédiats et mesurables pour la vie humaine. Les pires acteurs ne se soucient même pas du réseau électrique, branchant directement les centres de données à de nouvelles centrales électriques à combustibles fossiles construites sur mesure, qui nuiront à la population pendant des décennies après la dissipation du battage médiatique.
Les entreprises technologiques ont compris qu’elles devaient évoluer dans leur manière de contrôler le discours public autour des produits qu’elles fournissent, et elles réussissent ainsi à orienter le débat vers la responsabilité des consommateurs.
Il est déprimant de constater à quel point cela fonctionne, mais n’oubliez pas que rien de tout cela n’est inévitable. La première étape consiste à rejeter le cadre qui est aujourd’hui adopté avec désinvolture par une industrie qui consacre toute son énergie à donner une bonne image plutôt qu’à faire le bien.
