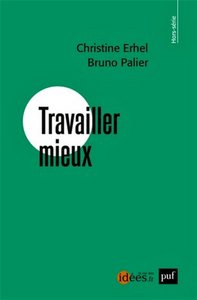
Bien qu’attachés à leur travail, les Français souhaitent en améliorer les conditions et la reconnaissance. Un enjeu tout à la fois social, économique, politique et environnemental.
Les Français sont parmi les Européens les plus attachés au travail, près des deux tiers d’entre eux affirmant que le travail est très important [1]. Cependant, pour beaucoup, la vie au travail en France est difficile : le nombre d’accidents du travail y est largement supérieur aux moyennes européennes (3,32 accidents mortels pour 100 000 personnes en emplois en France en 2021, contre 2,66 en Italie, 1,54 en Pologne, 0,84 en Allemagne, 0,77 en Suède ou 0,33 aux Pays-Bas, selon Eurostat), les conditions de travail sont souvent moins bonnes qu’ailleurs en Europe [2] ; de nombreuses personnes manquent de reconnaissance pour les tâches accomplies ; problèmes de santé au travail et perte de sens gagnent de nombreuses professions, y compris celles d’encadrement (perte de vocation des managers) [3].
Pour un nombre important de personnes, le travail est devenu insoutenable, notamment du fait de son intensification. Cela est particulièrement vrai pour le travail en seconde ligne [4] ou dans les métiers de la propreté [5], mais aussi, pour des raisons différentes, pour de nombreux cadres [6].
Face aux défis posés par les difficultés du travail en France, dans un contexte de mutation technologique et de transition écologique, cet ouvrage propose des pistes pour une meilleure qualité du travail et de l’emploi. Comment améliorer les conditions de travail, alléger les contraintes horaires, au bénéfice de la santé ? Comment répondre aux exigences de sens et de bien-être au travail ? Comment instaurer la démocratie au travail ? Comment changer les modalités d’organisation et de management du travail ? Comment utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le travail ? Comment travailler à l’heure du changement climatique et des exigences de la transition écologique ? (...)
Le malaise du travail en France
Parmi d’autres, l’ouvrage Que sait-on du travail ?, qui s’appuie sur de nombreux travaux de recherche en sciences sociales, documente et explique ces situations difficiles. Il y est montré que les modalités d’organisation du travail sont déterminantes pour expliquer les difficultés rencontrées. Les salariées et salariés sont de plus en plus souvent soumis à un management par les chiffres, hiérarchique, vertical et distant, qui laisse peu de place à l’autonomie et à l’horizontalité, et tient rarement compte de la réalité des conditions de production, ou des retours que les personnes concernées souhaiteraient pouvoir faire sur l’organisation du travail
La digitalisation a transformé le travail, mettant fréquemment les humains au service des machines, plutôt que l’inverse. (...)
Le télétravail a pu avoir des conséquences délétères du fait de la porosité accrue entre vie professionnelle et familiale, tout particulièrement pour les femmes.
Les situations ne sont pas uniformes. De nombreuses inégalités persistent au travail, le plus souvent en défaveur des moins qualifiés, des femmes, de certains jeunes, des handicapés et des personnes issues de l’immigration, et cela malgré la multiplication des plans d’action. (...)
Les difficultés au travail se donnent à voir de multiples façons. Les Françaises et Français manifestent contre une réforme des retraites qui leur demande de travailler plus longtemps dans des conditions perçues par beaucoup comme insoutenables. De nombreux secteurs se retrouvent « en tension » (les employeurs n’arrivent plus à recruter) du fait de rémunérations trop faibles pour des conditions de travail trop difficiles. La Dares, (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère en charge des questions du travail et de l’emploi) montre que les secteurs où les entreprises déclarent le plus rencontrer des difficultés de recrutement sont la construction, l’hébergement et la restauration, l’agroalimentaire, la fabrication de biens d’équipement et les transports et l’entreposage, secteurs dans lesquels les conditions de travail sont particulièrement difficiles et les niveaux de rémunération souvent plus faibles. La qualité de vie au travail devient ainsi une préoccupation majeure des partenaires sociaux comme des directions des ressources humaines. Comme l’a montré Thomas Coutrot parmi d’autres, les difficultés au travail participent aussi de la crise démocratique actuelle (...)
le travail se trouve de plus en plus sous pression des multiples transformations en cours, technologiques, environnementales, sociales et politiques…
Un monde du travail en transformation et en tension
La réflexion sur l’amélioration des conditions de travail et d’emploi s’inscrit dans un contexte général de tensions, liées à de multiples facteurs. En premier lieu, la poursuite du développement des outils numériques et le développement de l’intelligence artificielle constituent une vague d’innovations bien particulière, qui génère des craintes de plus en plus fortes de remplacement de l’homme par la machine, y compris dans des tâches intellectuelles, mais qui ne semble pas pour autant dynamiser la croissance de la productivité du travail.
Un second facteur de transformations de la structure de l’emploi et du contenu du travail provient de la transition écologique. Dans l’ensemble, les évaluations existantes (comme celles de l’Ademe – Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) mettent en évidence un potentiel de création d’emplois liée à la transition climatique de plus de 340 000 emplois équivalent temps plein à horizon 2035, et 900 000 à l’horizon 2050. Toutefois, ces créations d’emploi sont conditionnées à un réel investissement dans la transition et à des dépenses publiques supplémentaires (près de 30 milliards par an selon le rapport de Jean Pisani et Selma Mahfouz de 2023 [11]), consacrées à la rénovation des bâtiments publics, aux transports, à de subventions aux entreprises et aux ménages. De plus, elles impliquent également un effort de formation et de soutien aux transitions professionnelles, face à des besoins en compétences spécifiques et à des pertes d’emplois dans certaines activités (voitures thermiques par exemple). Enfin, les emplois verts ou « verdissants » (avec un contenu écologique même si ce n’est pas leur finalité principale) se caractérisent parfois par des conditions de travail difficiles, par exemple dans le traitement des déchets, ou même l’agriculture biologique, qui supposent un accompagnement spécifique.
Ces transformations technologiques et écologiques prennent place dans un contexte de crises à répétition, largement externes au monde économique, mais avec des conséquences fortes sur les ménages et les entreprises. Ce contexte de risques et de crises constitue une troisième composante de l’environnement du travail en tensions. C’est évidemment le cas de la crise sanitaire de 2020, crise exogène par excellence, qui a profondément transformé la gestion des ressources humaines et les politiques de l’emploi (...)
Enfin, le contexte politique et social a évolué et modifié les attentes à l’égard du travail. Si le travail reste aujourd’hui très important aux yeux des Français (62 % des Français déclarent que le travail est très important dans l’enquête European Value Survey – EVS – de 2017 [17]), on constate une importance accrue donnée au sens du travail, facteur primordial de satisfaction au travail selon les données de l’enquête internationale International Social Survey Program (ISSP). Pour la France, les analyses empiriques de Thomas Coutrot et Coralie Perez à partir des enquêtes sur les « Conditions de travail » (2013 et 2016) vont au-delà des effets sur la satisfaction déclarée et montrent un lien direct entre le sens du travail – mesuré à partir de l’utilité sociale, de la cohérence éthique, des capacités de développement des compétences – et les comportements des salariés en termes de démissions, de risques d’absence pour maladie ou de dépression (...)
Que faire pour améliorer la qualité du travail ?
Dans ce contexte de transformations et de défis, la question du travail est fondamentale pour la cohésion sociale et l’avenir de la démocratie, tout autant que pour une croissance économique soutenable. Elle ne peut pas être traitée au travers d’une perspective uniquement quantitative de créations ou de destructions de l’emploi, mais nécessite une attention sur la qualité du travail et de l’emploi dans ses différentes dimensions.
En se concentrant en premier lieu sur la lutte contre le chômage par la réforme du marché du travail et l’affaiblissement des protections des salariés, les politiques françaises n’ont pas été à la hauteur des enjeux de transformation du travail. En effet, les politiques de l’emploi ont été marquées par deux grands axes depuis la crise financière de 2008 : la poursuite de la logique de baisse du coût du travail, lancée avec les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires en 1993 ; et la flexibilisation du droit du travail. (...)
Les sciences sociales ont montré les difficultés au travail, mais la situation n’est pas désespérée, des améliorations sont possibles, des solutions existent. Avec notre série de propositions pour « travailler mieux », et avec cet ouvrage, nous souhaitons fournir au débat public un ensemble de mesures, de perspectives et d’orientations nouvelles dont les différents acteurs politiques, économiques et sociaux pourront se saisir. Il s’agit de présenter des voies de réponse aux difficultés et aux grands défis du travail sur la base des études, savoirs, enquêtes, comparaisons déjà réalisés et validés scientifiquement
