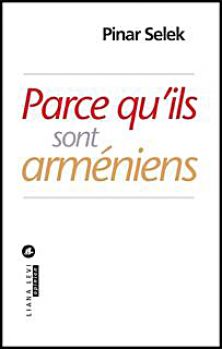
Nous sommes dans un collège d’Istanbul, peu après le coup d’Etat de 1980. On y chante, comme on le fera dans toutes les écoles jusqu’aux années 2000, tous les lundis matins et tous les vendredis après-midis, cet hymne nationaliste : « Heureux celui qui se dit turc ! » – et la formule est même inscrite au fronton de l’établissement. Fille d’un dissident emprisonné, Pınar Selek est en classe avec des dizaines d’adolescentes « obsédées par les marques », quelques filles d’intellectuels de gauche, deux Juives et quatre Arméniennes. C’est auprès de ces dernières qu’elle commence à ressentir, confusément d’abord, quelque chose que l’impitoyable monde militant, là-bas comme ici, méconnaît avec une grande brutalité, mais qu’elle finira par comprendre et qui est évoqué de manière à la fois très simple et très forte tout au long de son dernier livre, intitulé Parce qu’ils sont arméniens : la production de l’être timide par une intimidation, la production de l’être apeuré par une terreur infligée, la production de l’être mutique par une censure et une absence d’écoute, la production de l’être soumis par une violence, un massacre, un héritage traumatique – et, symétriquement, le paradoxal et problématique (et trop inquestionné) enracinement de l’éthique et de l’esthétique de la révolte dans la « cuirasse d’assurance » que confère une « identité dominante ».
En classe, ma main était toujours levée. Autant que mes mots le permettaient, je parlais d’égalité, de liberté, de paix. Et de temps à autre, j’osais même prononcer les mots « capitalisme » ou « fascisme ». Les caricatures me fixaient comme si j’étais une vilaine communiste. La situation de mon père les poussait sans doute à me tolérer. Dans toute l’école, aucune autre élève n’avait sa mère ou son père en prison. J’ai eu beau chercher, je n’ai trouvé personne. J’en avais parfois assez d’être la rebelle de la classe. Je me cherchais des complices.
Savez-vous qui étaient les plus silencieuses pendant ces cours ? Les Arméniennes…
Je me disais que je devais me rapprocher de ceux et celles que les fantoches insultaient, qui poussaient le dictateur à sortir de ses gonds. Que je devais prendre leurs mains et les poser sur mon coeur, glisser dans ces mains tous les poèmes en bouquet. Les Arméniennes n’étaient-elles pas les seules avec qui je pouvais partager le tourment qui me rongeait ? Il fallait que nous devenions amies. Ensemble, nous devions arracher le képi du dictateur et le jeter à terre !
Mais enfin, pourquoi ne répondaient-elles pas aux insultes ? (...)
