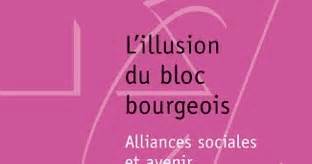
La victoire d’Emmanuel Macron est davantage un effet de la fragmentation politique conséquente à la crise des vieux partis, que de l’adhésion populaire à son projet[1]. Avec Bruno Amable, dans L’illusion du bloc bourgeois[2], nous avions envisagé le scénario qui se déroule sous nos yeux. Un pouvoir socialement minoritaire, fondé sur un compromis inédit entre des groupes auparavant séparés par le clivage droite/gauche et duquel sont exclues les classes populaires ; et qui, en utilisant comme levier l’adhésion à la construction européenne, se propose de reformer en profondeur le capitalisme français.
L’étroitesse de la base sociale de Macron n’est pas d’obstacle à la hauteur de son ambition « réformiste ». Au contraire, c’est la conscience de la fragilité du nouveau bloc social qui oblige Macron à agir vite et fort. On peut facilement prévoir qu’après le Code du travail, le gouvernement s’attaquera aux institutions qui organisent la protection sociale et le système de retraite, ou encore au périmètre des services publics et au statut de la fonction publique : car l’objectif est bien une transition rapide et complète du capitalisme français vers le modèle néolibéral[3].
Face à une attaque de cette ampleur, qui vise directement les intérêts sociaux les plus faibles, il est urgent de réfléchir à une stratégie d’opposition efficace, c’est-à-dire au profil d’une alliance sociale alternative au bloc bourgeois. Je discuterai deux perspectives différentes : la reconstruction du bloc de gauche, et la constitution d’une alliance « populiste ».(...)
en calculant le total des voix recueillies par les candidats de la France insoumise et du Parti communiste, on constate une progression de moins de 7 points par rapport au Front de gauche en 2012, alors que le PS et ses alliés ont perdu plus de 30 points. Et même si on veut analyser avec un peu de lucidité le score pourtant historique de Jean-Luc Mélenchon, qui a gagné 3 millions de voix à la présidentielle par rapport à 2012, il faut se rappeler que 9 millions de voix ont été perdues par le Parti socialiste et les écologistes. Dès le premier tour de la présidentielle, sur trois électeurs en fuite du Parti socialiste et ses alliés, un seul est resté à gauche.
Il faut s’interroger sur les difficultés, pour la gauche, d’intercepter le malaise social engendré par l’action de Hollande et Valls, car le quinquennat Macron est destiné à susciter des réactions du même ordre et d’une plus grande intensité : l’enseignement qu’il faut tirer du résultat électoral est que la gauche n’est pas le bénéficiaire naturel du mécontentement engendré par les reformes néolibérales. Au contraire, la gauche traverse une crise profonde car l’alliance sociale sur laquelle elle reposait est fracturée. Le bloc de gauche – qui dans sa très grande majorité exprimait des attentes pro-européennes et anti-libérales[5] – n’a jamais réuni l’ensemble des classes populaires : il correspondait à une alliance entre la fraction salariée de celles-ci, et des classes moyennes diplômées, liées au secteur public ou aux professions créatives et intellectuelles.
La fracture qui s’est ouverte au sein de l’alliance dans les années 80 et n’a cessé de s’amplifier depuis, est le produit de l’identification progressive entre la construction européenne et les réformes néolibérales. (...)
reconstituer le bloc de gauche pour bâtir une opposition solide à Macron supposerait de déconnecter la construction européenne et la transition vers le capitalisme néolibéral. Mais la promesse d’une autre Europe est usée, presque inaudible, et le bloc conservateur au pouvoir en Allemagne ne laisse – dans la configuration actuelle des rapports de force - aucune marge de négociation sur le contenu concret de l’unification.
La voie est ainsi étroite pour un projet qui aurait pourtant le mérite de faire obstacle à l’ambition réformatrice de Macron : non seulement en s’opposant à son action, mais en contestant la restructuration de l’espace politique qu’il essaie de produire, largement fondée sur le dépassement du clivage droite/gauche. Un constat (amer) peut ramener un peu d’optimisme : la gauche rencontre des problèmes analogues dans une grande partie du continent. L’alliance sociale produite par la médiation sociale-démocrate a explosé dans nombreux pays, pour partie - même si non exclusivement - à cause des réformes et de l’austérité dont est porteuse l’unification européenne[6].
Cela rend envisageable au moins l’hypothèse d’un mouvement coordonné qui viserait à établir un rapport de force différent avec l’Allemagne. La construction d’un cadre d’action commun à la gauche européenne apparaît dans ce sens une condition nécessaire pour donner une chance à la viabilité, dans les différents pays, de blocs sociaux progressistes, qui ne peuvent se ressouder qu’en trouvant le chemin vers une construction européenne différente de celle que nous connaissons.
Un point est clair : toute négociation, toute perspective d’une autre Europe, pour retrouver un minimum de crédibilité doit envisager la possibilité d’une rupture. En même temps, si l’objectif est la réunification du bloc de gauche, la rupture ne peut pas être conduite unilatéralement par un seul pays. (...)
tout repli nationaliste rentrerait en contradiction directe avec des attentes très répandues à gauche : au lieu de contribuer à la reconstruction de l’alliance sociale, le scénario d’une sortie unilatérale de l’UE produirait son explosion définitive.
Nécessité de construire un cadre commun à la gauche européenne, scepticisme sur la possibilité de négocier quoi que ce soit avec l’Allemagne, mémoire de tant de promesses jamais tenues sur une autre Europe possible : la stratégie qui se propose de ressouder le bloc de gauche a de quoi laisser dubitatif. Ce qui explique la tentation exercée par une option alternative : dans l’opposition à Macron, enterrer toute perspective de reconstruction de la gauche et, pour ainsi dire, passer à autre chose. Ce « autre chose » serait l’unité des classes populaires, celles auparavant intégrées au bloc de gauche mais aussi celles qui se reconnaissent, traditionnellement, dans les partis de droite. On peut qualifier ce projet de populiste, mais en levant d’abord l’ambiguïté du terme[7]. (...)
puisqu’elle vise la construction d’un bloc social différent, la perspective populiste est alternative à celle de la gauche. Il n’est pas compliqué d’apercevoir l’attrait que ce projet exerce sur une partie des militants et des dirigeants de la France insoumise ; mais, autant le dire clairement, c’est un projet qui a très peu de chances d’aboutir, et si jamais il était choisi comme objectif stratégique, il se révèlerait très probablement un trou noir en mesure de détruire durablement toute perspective d’arrêt des politiques néolibérales.
Soulignons d’abord que le projet populiste que je viens d’évoquer est dans une certaine mesure complémentaire à l’unification du bloc bourgeois, objectif de l’action du président Macron. Le bloc bourgeois, pour être viable, demande comme condition nécessaire le dépassement du clivage droite/gauche traditionnel, qui devrait être remplacé par un clivage Europe/nation. Le projet populiste s’appuie exactement sur ce même préalable. La relégation au deuxième plan de l’affrontement entre une droite et une gauche politique est nécessaire pour réunifier les classes moyennes et hautes autour de la poursuite de la construction européenne ; mais il s’agit aussi d’une condition indispensable pour ceux qui envisagent l’unification des classes populaires autour de la souveraineté nationale.
Le succès de la stratégie populiste, au sens de la construction d’un bloc inédit, est ainsi solidaire de la réussite du projet Macron. Du point de vue social, le projet populiste correspond à une alliance spéculaire à celle de référence pour le président de la République. (...)
La victoire d’Emmanuel Macron est davantage un effet de la fragmentation politique conséquente à la crise des vieux partis, que de l’adhésion populaire à son projet[1]. Avec Bruno Amable, dans L’illusion du bloc bourgeois[2], nous avions envisagé le scénario qui se déroule sous nos yeux. Un pouvoir socialement minoritaire, fondé sur un compromis inédit entre des groupes auparavant séparés par le clivage droite/gauche et duquel sont exclues les classes populaires ; et qui, en utilisant comme levier l’adhésion à la construction européenne, se propose de reformer en profondeur le capitalisme français.
L’étroitesse de la base sociale de Macron n’est pas d’obstacle à la hauteur de son ambition « réformiste ». Au contraire, c’est la conscience de la fragilité du nouveau bloc social qui oblige Macron à agir vite et fort. On peut facilement prévoir qu’après le Code du travail, le gouvernement s’attaquera aux institutions qui organisent la protection sociale et le système de retraite, ou encore au périmètre des services publics et au statut de la fonction publique : car l’objectif est bien une transition rapide et complète du capitalisme français vers le modèle néolibéral[3].
Face à une attaque de cette ampleur, qui vise directement les intérêts sociaux les plus faibles, il est urgent de réfléchir à une stratégie d’opposition efficace, c’est-à-dire au profil d’une alliance sociale alternative au bloc bourgeois. Je discuterai deux perspectives différentes : la reconstruction du bloc de gauche, et la constitution d’une alliance « populiste ».
L’alliance sociale fracturée de la gauche
Pour ce faire, il est tout d’abord nécessaire de prendre la mesure de la défaite subie par la gauche lors de dernières élections. La déroute du Parti socialiste s’explique par la contradiction entre les demandes qui provenaient de sa base électorale, dans laquelle des attentes « de gauche » étaient bien présentes, et le projet de modernisation du capitalisme français qui a guidé son action au moins depuis la moitié des années 80 [4]. Cependant, l’implosion du PS n’a profité qu’en faible partie aux forces qui s’opposent aux réformes destinées à remettre en cause les spécificités du modèle français. Le PS et ses alliés ont perdu 286 députés, PCF et France insoumise en ont gagné au total 17. Tous les seize députés perdus par le Parti socialiste, un seul est resté à gauche.
Ce résultat est pour partie lié au système électoral majoritaire et à l’incapacité de la gauche de proposer des candidatures communes au premier tour des législatives. Mais en calculant le total des voix recueillies par les candidats de la France insoumise et du Parti communiste, on constate une progression de moins de 7 points par rapport au Front de gauche en 2012, alors que le PS et ses alliés ont perdu plus de 30 points. Et même si on veut analyser avec un peu de lucidité le score pourtant historique de Jean-Luc Mélenchon, qui a gagné 3 millions de voix à la présidentielle par rapport à 2012, il faut se rappeler que 9 millions de voix ont été perdues par le Parti socialiste et les écologistes. Dès le premier tour de la présidentielle, sur trois électeurs en fuite du Parti socialiste et ses alliés, un seul est resté à gauche.
Il faut s’interroger sur les difficultés, pour la gauche, d’intercepter le malaise social engendré par l’action de Hollande et Valls, car le quinquennat Macron est destiné à susciter des réactions du même ordre et d’une plus grande intensité : l’enseignement qu’il faut tirer du résultat électoral est que la gauche n’est pas le bénéficiaire naturel du mécontentement engendré par les reformes néolibérales. Au contraire, la gauche traverse une crise profonde car l’alliance sociale sur laquelle elle reposait est fracturée. Le bloc de gauche – qui dans sa très grande majorité exprimait des attentes pro-européennes et anti-libérales[5] – n’a jamais réuni l’ensemble des classes populaires : il correspondait à une alliance entre la fraction salariée de celles-ci, et des classes moyennes diplômées, liées au secteur public ou aux professions créatives et intellectuelles.
La fracture qui s’est ouverte au sein de l’alliance dans les années 80 et n’a cessé de s’amplifier depuis, est le produit de l’identification progressive entre la construction européenne et les réformes néolibérales. Pour les électeurs de gauche une telle identification pose problème, car elle oblige à hiérarchiser entre des objectifs désormais perçus comme incompatibles : s’opposer aux réformes au point d’envisager (contre cœur) la sortie de l’UE, ou bien renouveler le soutien à la construction européenne même si elle impulse des réformes auxquelles on s’oppose ?
La question européenne
La division de la gauche n’est donc pas une fatalité provoquée par le prétendu égoïsme économique des bobos, catégorie d’ailleurs très mal fondée sociologiquement, ni par un imaginaire virage culturel des ouvriers vers des valeurs rétrogrades. La rupture de l’alliance est d’origine et de nature politique : reconstituer le bloc de gauche pour bâtir une opposition solide à Macron supposerait de déconnecter la construction européenne et la transition vers le capitalisme néolibéral. Mais la promesse d’une autre Europe est usée, presque inaudible, et le bloc conservateur au pouvoir en Allemagne ne laisse – dans la configuration actuelle des rapports de force - aucune marge de négociation sur le contenu concret de l’unification.
La voie est ainsi étroite pour un projet qui aurait pourtant le mérite de faire obstacle à l’ambition réformatrice de Macron : non seulement en s’opposant à son action, mais en contestant la restructuration de l’espace politique qu’il essaie de produire, largement fondée sur le dépassement du clivage droite/gauche. Un constat (amer) peut ramener un peu d’optimisme : la gauche rencontre des problèmes analogues dans une grande partie du continent. L’alliance sociale produite par la médiation sociale-démocrate a explosé dans nombreux pays, pour partie - même si non exclusivement - à cause des réformes et de l’austérité dont est porteuse l’unification européenne[6].
Cela rend envisageable au moins l’hypothèse d’un mouvement coordonné qui viserait à établir un rapport de force différent avec l’Allemagne. La construction d’un cadre d’action commun à la gauche européenne apparaît dans ce sens une condition nécessaire pour donner une chance à la viabilité, dans les différents pays, de blocs sociaux progressistes, qui ne peuvent se ressouder qu’en trouvant le chemin vers une construction européenne différente de celle que nous connaissons.
Un point est clair : toute négociation, toute perspective d’une autre Europe, pour retrouver un minimum de crédibilité doit envisager la possibilité d’une rupture. En même temps, si l’objectif est la réunification du bloc de gauche, la rupture ne peut pas être conduite unilatéralement par un seul pays. La voie, étroite et difficile, d’une autre Europe passe par la tentative d’établir un rapport de force qui doit intégrer la possibilité d’une rupture, mais d’une rupture qui coïnciderait avec la mise en œuvre immédiate d’une construction alternative (éventuellement privée de l’Allemagne et d’autres pays du nord du continent). Car tout repli nationaliste rentrerait en contradiction directe avec des attentes très répandues à gauche : au lieu de contribuer à la reconstruction de l’alliance sociale, le scénario d’une sortie unilatérale de l’UE produirait son explosion définitive.
Nécessité de construire un cadre commun à la gauche européenne, scepticisme sur la possibilité de négocier quoi que ce soit avec l’Allemagne, mémoire de tant de promesses jamais tenues sur une autre Europe possible : la stratégie qui se propose de ressouder le bloc de gauche a de quoi laisser dubitatif. Ce qui explique la tentation exercée par une option alternative : dans l’opposition à Macron, enterrer toute perspective de reconstruction de la gauche et, pour ainsi dire, passer à autre chose. Ce « autre chose » serait l’unité des classes populaires, celles auparavant intégrées au bloc de gauche mais aussi celles qui se reconnaissent, traditionnellement, dans les partis de droite. On peut qualifier ce projet de populiste, mais en levant d’abord l’ambiguïté du terme[7].
La stratégie populiste
L’adjectif « populiste » peut en effet correspondre simplement à une rhétorique, celle du peuple contre les élites, ou des pauvres contre les possédants, qui a depuis toujours sa place dans l’action de la gauche politique (même si, en tant que rhétorique, elle n’est pas une exclusivité de la gauche et elle n’est pas celle de l’ensemble de la gauche). J’utiliserai le terme « populiste » dans une acception différente, pour indiquer la tentative de rassembler une alliance sociale spécifique.
Dans ce sens, puisqu’elle vise la construction d’un bloc social différent, la perspective populiste est alternative à celle de la gauche. Il n’est pas compliqué d’apercevoir l’attrait que ce projet exerce sur une partie des militants et des dirigeants de la France insoumise ; mais, autant le dire clairement, c’est un projet qui a très peu de chances d’aboutir, et si jamais il était choisi comme objectif stratégique, il se révèlerait très probablement un trou noir en mesure de détruire durablement toute perspective d’arrêt des politiques néolibérales.
Soulignons d’abord que le projet populiste que je viens d’évoquer est dans une certaine mesure complémentaire à l’unification du bloc bourgeois, objectif de l’action du président Macron. Le bloc bourgeois, pour être viable, demande comme condition nécessaire le dépassement du clivage droite/gauche traditionnel, qui devrait être remplacé par un clivage Europe/nation. Le projet populiste s’appuie exactement sur ce même préalable. La relégation au deuxième plan de l’affrontement entre une droite et une gauche politique est nécessaire pour réunifier les classes moyennes et hautes autour de la poursuite de la construction européenne ; mais il s’agit aussi d’une condition indispensable pour ceux qui envisagent l’unification des classes populaires autour de la souveraineté nationale.
Le succès de la stratégie populiste, au sens de la construction d’un bloc inédit, est ainsi solidaire de la réussite du projet Macron. Du point de vue social, le projet populiste correspond à une alliance spéculaire à celle de référence pour le président de la République. La stratégie populiste s’adresse aux groupes qui se retrouvent exclus du bloc bourgeois. Par conséquent, elle néglige les attentes des classes que le bloc bourgeois essaie de réunir en utilisant comme levier le thème de l’unification européenne. Ces deux projets, qui s’opposent, sont donc tributaires chacun de l’affirmation de l’autre. Pour le dire simplement : la consolidation du bloc bourgeois faciliterait l’agrégation d’une alliance populiste autour du thème de la souveraineté nationale, tout comme une opposition axée sur le souverainisme et la rupture avec l’Europe favoriserait la tentative de consolider le bloc bourgeois.
Maintenir la référence à la gauche
Il est important de répéter que, pour l’instant, le bloc bourgeois est loin de s’être imposé comme bloc dominant, la victoire électorale d’Emmanuel Macron étant bien plus liée à la fragmentation politique qu’à l’adhésion à son projet. La référence au bloc de gauche offre un double avantage par rapport à la stratégie populiste en termes d’efficacité immédiate dans l’opposition à Macron. D’une part car en réaffirmant le clivage droite/gauche, elle conteste un préalable fondamental à l’émergence du bloc bourgeois. D’autre part, la tentative de faire vivre le bloc de gauche implique une offre politique adressée à une fraction des classes populaires, mais aussi à des classes qui devraient être intégrées au bloc bourgeois (les classes moyennes diplômées qui n’ont aucun enthousiasme pour les réformes néolibérales mais montrent un fort attachement à la construction européenne), en faisant ainsi directement obstacle à son affirmation comme bloc hégémonique. (...)
Il faut d’abord souligner la distance abyssale qui sépare les classes populaires traditionnellement reliées à la droite de celles qui, avant de se réfugier massivement dans l’abstention, demandaient à la gauche d’en protéger les intérêts, au niveau des valeurs dont elles sont porteuses – on pourrait dire de leurs « visions du monde ». À titre d’exemple, un sondage récent[8] indique que les valeurs les plus caractéristiques de l’électorat Le Pen au premier tour de la présidentielle sont le sens de la famille, la fidélité, le sens de la rigueur, l’authenticité et la complicité ; alors que l’électorat Mélenchon (l’autre candidat ayant su recueillir le soutien d’une fraction des classes défavorisées) indique comme valeurs fondamentales l’égalité, l’humanité, la solidarité, la fraternité et la diversité. On imaginerait difficilement éloignement plus profond. (...)
Le parcours du Front national est d’ailleurs indicatif de la difficulté, voire de l’impossibilité, de réaliser l’unité de l’ensemble classes populaires. Ce parti a profité de la crise des alliances sociales traditionnelles pour ajouter au soutien initial d’artisans, commerçants, petits entrepreneurs, celui d’une fraction des ouvriers et des employés – catégories qui, par ailleurs, faute d’une offre politique correspondante à leurs intérêts, se sont massivement réfugiées dans l’abstention. La ligne suivie par le Front national au cours de la période la plus récente, dictée par Marine Le Pen et Florian Philippot, correspond à une stratégie populiste dans le sens défini plus haut. Mais la dernière campagne présidentielle a montré on ne peut plus clairement que le FN ne dispose d’aucune stratégie de médiation entres les groupes qui l’appuient.
Sur les retraites, le rapport salarial, l’assurance maladie etc., le FN n’a pas été en mesure d’arrêter une position claire pour la simple raison que n’importe quelle position l’aurait mis en porte à faux avec une fraction de son propre électorat. Si l’on excepte la sortie de l’euro et de l’UE, défendue avec bien d’incertitudes par la candidate frontiste, force est de constater que le Front national a mené campagne exclusivement sur des thèmes non directement connectés à la politique économique comme la souveraineté nationale, l’insécurité, l’identité française, l’immigration, l’islam, la laïcité. Evidemment, la stratégie du FN a des spécificités très fortes, notamment à cause de l’arrière-plan d’extrême droite qui la caractérise. Mais l’exemple italien du Mouvement 5étoiles, qui est né directement avec l’ambition « populiste » définie plus haut et qui n’est conditionné par aucun héritage idéologique, donne des indications du même ordre. (...)
La campagne Mélenchon, entre stratégie populiste et reconstitution d’un bloc de gauche
Deux voies peuvent être empruntées, qui présentent chacune des obstacles majeurs. Celle qui pourrait mener à la reconstruction du bloc de gauche suppose de s’adresser aussi à une fraction des classes moyennes diplômées ayant voté pour Macron malgré le signe néolibéral des réformes qu’il annonce, car il était à leurs yeux le candidat le mieux placé pour défendre la construction européenne. C’est une voie difficile et laborieuse, qui passe par une action commune aux gauches européennes, indispensable pour redonner un minimum de crédibilité à la perspective d’une autre Europe. La voie populiste est seulement d’apparence plus facilement praticable : en concédant au nouveau pouvoir l’exclusivité de la défense de l’unification européenne, et celle de la représentation des classes moyennes et supérieures, et en faisant de la souveraineté nationale son thème fédérateur, cette voie est destinée avec toute probabilité à se révéler sans issue, étant donnée la difficulté d’imaginer une politique de médiation capable de satisfaire l’ensemble des classes populaires.
Entre un chemin difficile et une impasse, le choix devrait être vite fixé. Mais la gauche française, ou ce qui en reste – c’est-à-dire pour l’essentiel la France insoumise –, semble hésiter, ou plus précisément apparaît divisée sur la perspective à privilégier. La campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon peut être interprétée comme un exercice d’équilibre en mesure de laisser une chance aux deux possibilités : la reconstruction du bloc de gauche, ou la formation d’une alliance nouvelle autour de l’unité des classes populaires. Le programme de la France insoumise, L’Avenir en commun, était clairement orienté à gauche ; le style de la communication et, surtout, les attaques contre les autres composantes de la gauche (plusieurs fois renouvelées depuis) allaient plutôt dans le sens de la stratégie populiste.
Cette ambiguïté entretenue entre deux projets différents, qui s’est révélée très efficace le temps d’une campagne électorale, est cependant destinée à montrer vite ses limites : notamment sur la question européenne qui est le nœud politique qu’il faudra dénouer rapidement si l’on veut donner des bases claires et solides à l’opposition à Macron. Soit on privilégie directement la rupture, unilatérale si nécessaire, avec l’UE, et par conséquent on renonce à renouveler l’alliance de gauche traditionnelle ; soit on cherche d’établir un rapport de force différent avec les conservateurs allemands par une action commune aux gauches européennes, ce qui n’implique pas de renoncer à l’éventualité d’une rupture, mais de l’envisager seulement comme un dernier recours, et comme coordonnée et multilatérale. Même sur cette question, la position du candidat Mélenchon se prête à une double lecture (...)
Si le mouvement d’Emmanuel Macron et le Front national ont des bases qui correspondent au nouveau clivage Europe/nation, le socle électoral de la France insoumise apparaît largement structuré par le clivage droite/gauche : l’abandonner en faveur de la stratégie populiste comporterait ainsi un risque politique majeur.
Le renouveau du bloc de gauche apparaît donc comme la seule perspective pour faire obstacle à la transition du capitalisme français vers le modèle néolibéral. Rien n’est simple si l’on vise cet objectif, car il s’agit de reconstruire une alliance sociale profondément abimée et fracturée. Ce travail de reconstruction suppose non seulement de faire preuve d’imagination pour identifier des médiations nouvelles entre des attentes diversifiées ; il demande aussi de résister aux acteurs politiques, intellectuels, médiatiques - et ils sont nombreux – qui travaillent activement pour la dissolution définitive de l’alliance de gauche (...)
